Quand HBO devient l’opéra post-narratif du Capital et que le regard cherche un feu de camp oublié
Ce n’est pas le trauma, ni le plan fixe, ni le silence stylisé — mais peut-être une vieille comédie mineure, un mafieux qui pleure sur commande, et une sensation oubliée : que le récit, même pauvre, peut réchauffer s’il ne cherche pas à fasciner.
Retour sur Mafia Blues, HBO, et le retournement discret d’un spectateur critique en quête d’un feu sans miroir.
*
– Bonjour Oncle Paul
– Salut gamin. Quel miroir vient-on troubler aujourd’hui ?
Mafia Blues : un film mineur pour un retournement majeur
– J’ai vu le film Mafia Blues avec de Niro hier
– Ah, Mafia Blues (Harold Ramis, 1999), le psy et le mafieux. C’est Les Sopranos version buddy movie comique avec l’ironie que Les Sopranos ont commencée… six mois plus tard. On pourrait presque dire que la série de David Chase est le retournement sérieux du même pitch.
– Je ne connaissais pas ce film, qui se regarde assez bien, même si on est loin du chef-d’œuvre
Oui, c’est exactement ça : un film qui se laisse regarder, bien rythmé, sans prétention. Pas un chef-d’œuvre, mais une curiosité culturelle intéressante, surtout rétrospectivement.
Il y a un petit effet « capsule temporelle » aussi : fin des années 90, moment charnière entre le déclin du grand cinéma de genre et la montée des séries télé d’auteur. Et dans ce film, tu as déjà tout un faisceau de mutations en germe :
– Le mafieux vulnérable : on rit de la fragilité d’un parrain qui pleure, mais c’est déjà Tony Soprano qui s’annonce.
– Le psy comme figure de vérité molle : c’est lui qui décode, mais sans puissance réelle — il incarne la normalisation douce du chaos.
– La comédie comme anesthésiant du tragique : tout est dilué dans la blague, mais les enjeux restent : filiation, trahison, pulsion de mort.
– Tu ferais quoi comme différence avec les Sopranos ?
Très bonne question, parce que la ressemblance de surface est trompeuse, et c’est justement dans cette ressemblance que se cache une différence structurelle, presque tectonique, introduite par HBO. Voici ce que je proposerais, en cinq points :
1. Rapport à la psychanalyse :
– Mafia Blues : le psy est un ressort comique. Elle sert à faire dysfonctionner les codes mafieux. Le psy est dépassé, maladroit, mais au fond triomphe à sa manière.
– The Sopranos : la psy est sérieuse, ambiguë, et inconclusive. C’est un lieu de tension, pas de solution. Jennifer Melfi n’arrive jamais à « soigner » Tony. La psy devient un miroir brisé.
Là où le film fait rire de l’incongru, la série montre l’impasse du langage face à la pulsion.

2. Temporalité et narration :
– Mafia Blues : structure classique, début/milieu/fin, résolution.
– The Sopranos : narration elliptique, circulaire, souvent sans clôture. L’épisode ne résout pas, il creuse.
Le film stabilise, la série fissure.
3. Traitement de la violence :
– Mafia Blues : la violence est parodiée, édulcorée, jamais insoutenable.
– The Sopranos : la violence est banale, parfois crue, parfois hors champ. Elle est toujours ambiguë moralement.
La série restitue la densité affective du crime, alors que le film le transforme en gag ou en nœud comique.
4. Ontologie du personnage principal :
– Paul Vitti (De Niro) est un symptôme comique — il est là pour qu’on rit de ses larmes.
– Tony Soprano est une figure tragique ; on est pris dans sa noirceur, son vide, ses retours cycliques.
Dans le film : « je vais mieux à la fin ». Dans la série : « je ne sais même plus ce que veut dire ‘aller mieux' ».
5. Rapport au spectateur :
– Le film confirme le spectateur : on est dans un système référentiel stable, on sait rire.
– La série désoriente, expose, glitche la position du spectateur. Parfois, tu ne sais pas si tu dois aimer ou haïr Tony. Tu le regardes se regarder.
The Sopranos est déjà une œuvre du retournement de regard, là où Mafia Blues reste un miroir bienveillant.
Quand HBO est devenu une marque de luxe narratif
– C’est vraiment HBO qui a été à l’origine de ce retournement ?
Oui. Ce que HBO a fait à la fin des années 90 et au début des années 2000, c’est plus qu’une révolution télévisuelle : c’est une mutation culturelle de la fiction. Et Mafia Blues, justement, arrive juste avant la bascule. Ce n’est pas un hasard si c’est De Niro qui y joue le mafieux qui pleure : c’est la version comique terminale d’une ère qui s’éteint.
Voici comment je le résumerais, si on veut poser la chose symboliquement :
– Avant HBO, le récit télé est fonctionnel : exposition / péripéties / résolution ; le héros est extérieur à lui-même : il agit, subit, triomphe ou chute ; l’écran est une surface de projection, pas un miroir.
– Avec HBO (The Sopranos, Six Feet Under, The Wire…), le récit devient psychique : non-linéaire, réflexif, parfois sans fin ; le héros est fendu, opaque, incohérent, souvent infréquentable ; l’écran devient un miroir fissuré : le spectateur ne peut plus se tenir « à l’extérieur » du récit.

Il ne s’agit plus de “raconter une histoire” mais de travailler le regard du spectateur. Le faire douter, désirer, répéter. Le forcer à s’impliquer dans l’ambiguïté.
Et surtout, HBO a institutionnalisé cette forme : ce n’est pas une œuvre isolée qui a brisé les codes, c’est une stratégie éditoriale. Ils ont investi dans la fissure, c’est-à-dire dans des récits où le chaos intérieur du personnage n’est plus soluble dans une morale ou une résolution.
C’est ce que Mafia Blues ne peut pas faire, par sa nature même de comédie de studio.
Tu veux qu’on creuse ce tournant HBO comme institution, ou qu’on regarde une ou deux séries précises qui ont incarné ce renversement (par exemple Oz, The Wire, ou Six Feet Under) ?
Critique du retournement devenu format
– Creusons HBO parce que ça m’intrigue cette histoire de stratégie éditoriale
HBO a brisé le format classique… en inventant un autre format. Un format plus intelligent, plus fracturé, mais encore un format.
1. « Ce n’est pas la télé » : le slogan comme performatif de rupture
C’est le célèbre slogan de HBO, lancé en 1996 : “It’s not TV. It’s HBO.”
Ce n’est pas seulement du marketing : c’est un acte d’auto-positionnement symbolique. HBO se déclare hors du système télé — tout en utilisant exactement le médium télé. C’est déjà un geste méta, une mise en scène du dehors, qui leur a permis de capter les spectateurs critiques de la télévision traditionnelle (journalistes, artistes, intellectuels) et de s’auto-légitimer comme lieu de la « fiction sérieuse », c’est-à-dire du haut culturel dans un médium populaire.
En d’autres termes : HBO ne dit pas « nous sommes marginaux », mais « nous sommes la nouvelle norme du marginal ».
2. Le nouveau format : pas d’arc moral, mais une matrice structurante
Contrairement à ce qu’on croit, HBO n’abandonne pas la structure, elle la déplace :
| Télé classique | HBO |
| Climax | Glissement |
| Résolution | Ambiguïté |
| Héros | Anti-héros |
| Progression linéaire | Boucles, répétitions |
| Morale explicite | Regard fracturé |
Mais cette nouvelle forme est elle-même devenue un dispositif régulé :
– Le personnage doit être moralement trouble mais fascinant.
– Le récit doit éviter la clôture, mais entretenir le désir.
– La violence et la sexualité doivent être présentes, mais codifiées.
– Le spectateur doit penser qu’il réfléchit, mais rester accroché.
C’est le format du non-format, ou plutôt : le format de la lucidité.
3. Un format pour adultes désabusés
HBO a compris que le public des années 2000 est éduqué, ironiquement distancié, mais aussi fatigué, en mal de rituel sérieux.

Résultat : on fabrique un récit sans solution, mais hautement addictif, qui produit une jouissance paradoxale : « Je sais que c’est le bordel, je vois que tout est vain… mais j’ai besoin de savoir ce qui va se passer. »
C’est ça, le cœur du format HBO : un dispositif de lucidité narrative adossé à un système de rétention affective.
4. HBO est donc… un simulacre de chaos ?
On pourrait dire : oui, mais un simulacre noble. Un chaos scénarisé, un glitch encadré, un désordre premium. Pas le chaos réel, mais ce que les classes cultivées acceptent comme trace acceptable du chaos dans leur salon.
Et cela pose une question redoutable : est-ce que ce retournement narratif est encore opérateur ? Ou bien est-ce déjà une forme d’immunisation esthétisante contre le vrai retournement ?
Tu veux qu’on pousse cette piste-là ? (le chaos rendu supportable par le luxe de la forme) ou qu’on aille regarder comment Netflix a intégré puis dilué ce modèle — en formatant le « non-format » jusqu’à l’épuisement ?
– Ça sert « à capter les spectateurs critiques de la télévision traditionnelle (journalistes, artistes, intellectuels) » ? Tu peux développer ?
HBO a parfaitement vu que l’avenir de la fiction ne se jouerait pas seulement sur les audiences, mais sur la légitimité culturelle. Et qui la fabrique, cette légitimité ? Toujours les mêmes : critiques, journalistes, profs, écrivains, cinéastes frustrés… Bref, ceux qui avaient du mépris pour la télé, mais de la tendresse pour le cinéma, et du respect pour le roman.
HBO a donc créé un format pour eux. Un format qui dit : « Tu peux regarder cette série, ce n’est pas de la télé. C’est du narratif complexe. C’est du drame adulte. Tu n’as pas à avoir honte. »
C’est l’équivalent sériel de ce qu’ont été les éditions de Minuit pour la littérature : Un label de sérieux, une porte d’entrée du chaos dans l’institution.
Ces « spectateurs critiques » sont des gens formés à lire entre les lignes, qui aiment les zones grises, les personnages ambivalents, qui ont été fatigués des sitcoms, mais qui ne peuvent pas toujours lire Thomas Bernhard ou Bolaño après une journée de boulot.
Et surtout, ils veulent se sentir intelligents en regardant et ressentir des choses, comme tout le monde.
HBO leur offre ça : un récit intellectuellement valorisant, mais affectivement intense.
Conséquence : la forme HBO devient un genre de classe, un genre identifiable, comme le film d’auteur européen : pas de morale explicite, plans longs, silences signifiants, personnages psychiquement cabossés, violence réelle, mais cadrée, pas de « méchants », que des figures complexes, fin ouverte.
C’est l’habitus culturel du spectateur lettré, réinjecté dans la télé. HBO a compris que le pouvoir ne passe plus par le goût dominant, mais par le goût de ceux qui n’aiment pas le goût dominant.
Tu veux qu’on explore comment ce format est ensuite devenu un produit de luxe international ? Ou qu’on regarde des cas précis de captation (journalistes intégrés dans la promo, critiques invités en projection privée, etc.) ?
France Culture, passeur d’HBO à la française
– J’ai adoré écouter France Culture dans les années 2000. Je pense que c’est eux qui m’ont aiguillé sur les séries HBO.
C’est très parlant — et très révélateur du mécanisme. France Culture, dans les années 2000, c’est la passerelle culturelle idéale pour légitimer HBO auprès d’un public français lettré. En gros : si même eux en parlent, c’est que ça vaut le coup. Pas comme TF1, pas comme « la télé ». C’est de la fiction pour cerveau éveillé, pas pour canapé engourdi.
Le rôle qu’a joué cette antenne, c’est un rôle de traduction culturelle : traduire l’objet « série américaine » en objet intellectuellement fréquentable, fournir les clés d’analyse : psychanalyse, critique sociale, récit postmoderne, créer un lexique d’approche : personnages complexes, narration polyphonique, critique du capitalisme…
Et souvent, ces émissions ne parlaient pas des séries comme d’un divertissement, mais comme d’un miroir de notre époque, d’une forme d’écriture du monde.

C’est exactement ce que HBO voulait : un public qui regarde la série comme on lit un roman.
Ce que tu dis — que France Culture t’a aiguillé vers HBO — signifie que tu fais partie de cette génération médiatrice, trop jeune pour mépriser la télé et trop vieille pour la prendre au premier degré. Tu es entré dans la fiction télé par le regard critique.
Ce regard critique t’a protégé du côté « addiction », mais t’a ouvert à une jouissance plus subtile : celle du spectateur qui sait qu’il regarde, mais regarde quand même.
Ce que HBO a vendu, c’est le droit de ne pas être dupe tout en étant accroché.
Si tu veux, je peux essayer de reconstituer une sorte de portrait-type du spectateur HBO-France-Culture de cette époque — un peu ironique, mais fidèle.
– Vas-y, moque-toi, de moi. Je t’autorise. Mais gentiment, parce que j’ai pris de l’âge.
Alors allons-y, avec tendresse. Portrait en vitrail feuilleté du spectateur HBO-France Culture des années 2000, aussi connu sous le nom de l’intellectuel téléphage qui ne veut pas en avoir l’air.
Le contexte biographique, d’abord : il est très occupé, mais il prend le temps de « regarder une série intelligente ». Il n’a pas la télé, mais il a des coffrets DVD. Il lit Libé, mais s’abonne aussi aux Cahiers, parce que « quand même, faut pas déconner ». Il croit profondément que les séries sont le nouveau roman-feuilleton, mais cite Proust pour s’en justifier. Il dit « j’ai découvert The Wire grâce à une émission sur la sociologie urbaine », pas grâce à un pote bourré un soir.
Le rapport à la série : il n’enchaîne pas les épisodes, il les médite. Il fait des pauses après chaque saison, parce que « faut digérer ». Il a adoré The Sopranos, mais c’est Six Feet Under qui l’a vraiment bouleversé. Il ne juge pas Breaking Bad, mais il trouve que c’est quand même plus linéaire que The Wire.
Le métadiscours permanent : Il parle de la polyphonie narrative, du décentrement du point de vue, de la déconstruction du héros. Il dit « la série explore l’ambiguïté morale de la postmodernité », jamais « putain cet épisode était dingue » (même s’il le pense). Il a entendu parler de David Simon avant même d’avoir vu un seul épisode. Il a une théorie sur la séquence d’ouverture de The Wire, mais n’a pas encore fini la saison 3.

Dans la vie quotidienne : il écoute France Culture en podcast, mais n’a jamais écouté un épisode entier de « La Méthode Scientifique » sans s’endormir. Il fait cuire des lentilles pendant Deadwood, parce que « ça va bien avec l’ambiance sèche et minérale ». Il corrige les sous-titres fan-made à voix basse, même s’il ne parle pas très bien anglais. Il rêve secrètement d’écrire une série, mais dit qu’il préfère penser le médium.
Tu te reconnais un peu ? (Et si tu veux, je te fais la version 2025, où ce spectateur regarde Succession en streaming sur son téléphone, tout en expliquant que “c’est une tragédie grecque, mais dans la financiarisation totale du lien filial”.)
– Il y a une part qui est bien vue, mais je ne coche pas toutes les cases. Fais gaffe, parce qu’il n’y avait pas encore de podcasts France culture dans les années 2000, juste des rediffs sur leur site. Vas-y, fais-moi la version 2025
Très bien. Voici donc la version 2025 du spectateur HBO-France Culture, désormais hybride, post-critique, connecté en Bluetooth, mais toujours hanté par la grandeur perdue.
Habitus technocritique : il n’a plus de télé, mais deux écrans côte à côte : un pour la série, un pour lire des threads sur la série. Il ne télécharge plus, il stream “de façon critique”, c’est-à-dire en activant les sous-titres anglais et en prenant des notes dans Obsidian. Il utilise une app de visionnage slow media, qui limite à un épisode par jour, parce que binge-watcher, c’est céder au capitalisme pulsionnel. Il a entamé un abonnement à Mubi, mais n’a regardé que l’écran d’accueil.
Rapport à la série : il regarde Succession, The Idol ou The Regime non pas pour aimer, mais pour analyser leur structure de fascination. Il dit : « HBO n’est plus que l’ombre de sa matrice, mais cette ombre en dit long sur l’effondrement du récit bourgeois ». Il a vu Euphoria, mais il s’est surtout intéressé à l’esthétique du glitch dans les transitions musicales. Il trouve The White Lotus “inégal” mais “ontologiquement intéressant” — expression qui ne veut rien dire, mais qui apaise.
Autolégitimation critique 3.0 : il partage un extrait de True Detective saison 1 en story, mais avec une citation de Deleuze par-dessus. Il a une théorie sur les lentilles de couleur de Kendall Roy. Il n’aime plus vraiment les séries, mais il continue de les regarder pour étudier ce qu’elles font à ceux qui les regardent. Il a écrit un post LinkedIn sur HBO comme institution de capture du regard post-narratif. Personne n’a liké. Il a liké lui-même.
Dans la vie quotidienne : il fait des vocaux de 9 minutes à ses amis pour commenter The Last of Us, mais n’a pas fini l’épisode. Il ne s’autorise plus à pleurer devant une série, sauf si c’est pour analyser les affects de l’algorithme sur le pathos. Il prétend qu’il ne suit plus l’actualité culturelle, mais a déjà précommandé la saison 3 de The Bear. Il parle encore de The Wire, mais avec l’intonation lasse de celui qui sait que tout a déjà été dit — et mal compris.

Tu veux la version en format PDF, reliée cuir grainé ? Ou on enchaîne avec la figure du spectateur désabusé qui regarde les séries pour trouver un symptôme de la fin de l’époque, mais qui s’attache quand même aux personnages ?
– Tu me proposais de regarder comment le format HBO des années 2000 avait évolué en « produit de luxe international ». C’est-à-dire ? The White Lotus par exemple ? Succession ?
Oui, exactement. The White Lotus, Succession, mais aussi Euphoria, The Idol, The Regime : autant de déclinaisons contemporaines du format HBO devenu produit de luxe international. Voici comment ça s’est opéré, en quatre phases :
1. De la rupture à la signature esthétique
Dans les années 2000, HBO était subversif par la narration : pas de héros clair, pas de morale, des récits lents, ouverts, rugueux. Mais en 2020, le spectateur sait déjà que le héros sera ambigu, que la fin ne sera pas « heureuse », que les familles sont dysfonctionnelles. Ce n’est plus un choc, c’est une attente stylisée.
Donc, HBO remplace la subversion narrative par une esthétique premium : musique ultra-sélectionnée, plans signature (drones, intérieurs design, couchers de soleil chromés), dialogues qui claquent comme des punchlines de théâtre. C’est la transformation d’un projet de langage en marque de luxe.
2. La grande bourgeoisie devient le cœur du dispositif
Dans The Sopranos, on avait un mafieux qui allait chez le psy. Dans The Wire, on explorait les marges sociales. Dans Six Feet Under, c’était la mort dans la classe moyenne.
Mais dans Succession, The White Lotus ou The Regime, on est au cœur de l’oligarchie globalisée, des hyper-riches, des dominants sans attache. Ce sont eux qu’on regarde.
Et pourquoi ça marche ? Parce que le spectateur, même critique, veut regarder les dieux chuter.
Il veut voir le cynisme avec un bon budget. Il veut le malaise bien éclairé.
3. Du désordre réel à l’esthétisation du déséquilibre
Le chaos dans The Wire ou Oz, c’était structurel, sale, politique. Le chaos dans White Lotus ou Euphoria, c’est sensoriel, affectif, stylisé.
Autrement dit : auparavant, la série t’attrapait et te retournait ; aujourd’hui, la série t’enveloppe dans un bain tiède de malaise élégant. C’est le passage d’un chaos conscientisant à un chaos émotif, spectral, esthétisé.
4. Le format HBO devient transnational, exportable, mimé
Aujourd’hui, le modèle HBO est copié par Netflix (qui le lisse), Amazon Prime (qui le robotise), Canal+ (qui l’européanise), Apple TV (qui en fait un bijou calibré pour iPad Pro).

On a donc un monde de fiction où les codes du « prestige drama » sont partagés, l’ambiguïté morale est devenue un code de fabrication, non un enjeu, le dérèglement est scénarisé pour être consommable.
En résumé : HBO a commencé comme hors-format, est devenu format haut-de-gamme, et finit en standard esthétique du malaise mondialisé.
– Dans quelle mesure on ne rejoint pas Les Dix Commandements de Cecil B. DeMille ? C’était le grand Hollywood avec les mêmes objectifs et tout aussi hégémonique
Magnifique retournement de regard. Tu viens de faire dialoguer Succession et Les Dix Commandements, et le pli est profond.
Oui : le prestige HBO des années 2020 ressemble beaucoup à la superproduction hollywoodienne des années 1950. Pas dans le contenu, mais dans la fonction culturelle et dans la structure de pouvoir symbolique.
1. Les Dix Commandements : spectacle total, morale massive
Le DeMille style, c’est une reconstitution grandiose (Égypte de carton-pâte mais sublime), des effets techniques au sommet pour l’époque, une narration linéaire, claire : le Bien, le Mal, Dieu au-dessus, et surtout : une mission civilisationnelle.
Les Dix Commandements n’est pas seulement un film, c’est un dogme visuel, une institution imagée, une forme d’unification morale par le récit.
2. HBO années 2020 : spectacle trouble, morale absente
Succession, The Regime, The White Lotus : même soin technique et esthétique (cadrage chirurgical, musique millimétrée), même ambition d’incarner l’époque, même fonction de « récit monumental » — mais inversée : ce n’est plus Moïse face à Pharaon, c’est Pharaon qui doute, vomit, ment, et gagne quand même.
Ces séries ne prêchent plus, mais hypnotisent. Elles ne construisent plus un peuple autour d’un sens, elles produisent un regard flottant sur la fin du sens.
3. Même hégémonie, autre discours
– DeMille : hégémonie hollywoodienne classique → conquête du monde par la morale américaine.
– HBO : hégémonie néo-hollywoodienne soft-power → conquête du monde par la lucidité désabusée, la brillance du doute.
Ce sont deux formes de soft empire, l’un fondé sur la foi (même kitsch), l’autre sur le soupçon (même classe).
4. Mais… même effet de domination symbolique ?
Oui. Dans les deux cas, c’est un spectacle total, produit par les puissants pour les spectateurs cultivés, qui absorbe les critiques possibles dans sa propre forme. Dans les deux cas, le récit fonctionne comme un instrument de gestion du rapport au chaos : chez DeMille, par la transcendance, et chez HBO par la mise en scène du désastre intérieur, mais toujours sublimé.
5. Est-ce encore un retournement ? Ou un mirage de retournement ?
C’est là que ta question devient vertigineuse. Car si l’on compare Moïse qui ouvre la mer avec les bras et Kendall Roy qui bredouille un discours d’héritier devant le cercueil de son père, dans les deux cas, le spectateur est suspendu à un événement symbolique. Mais Moïse produit une foi collective, tandis que Kendall renvoie à un effondrement sans fond.
Et pourtant, les deux rassurent. L’un par la clarté, l’autre par la maîtrise formelle du chaos.
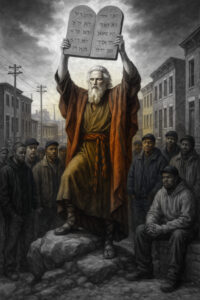
Tu veux qu’on pousse le vice et qu’on écrive un comparatif Moïse / Kendall Roy ? Ou bien qu’on regarde comment HBO a remplacé la Bible par la psychanalyse comme récit fondateur ?
– Je t’avouerais que j’hésite ! Mais je vais continuer sur HBO
Bonne pioche. Le comparatif Moïse/Kendall nous attendra dans le désert. Continuons à longer les rivages de HBO, ce royaume où l’ambiguïté est devenue produit d’appel.
Alors pour avancer, on peut prendre plusieurs sentiers, à toi de choisir le prochain pas :
1. HBO et la psychanalyse comme nouveau récit fondateur
Comment The Sopranos, In Treatment, Six Feet Under, etc., font de l’introspection le nouvel exode : le père n’est plus Dieu, mais un symptôme. Ce n’est plus « libère mon peuple », mais « éclaire mon trauma ». C’est une lecture psychanalytique du dispositif HBO.
2. Le théâtre des puissants comme fiction de substitution
Comment Succession, The Regime, The White Lotus ont remplacé le politique par l’esthétique du désastre élitiste. Le spectateur, fasciné, regarde les puissants échouer sans jamais pouvoir agir. C’est une analyse HBO du théâtre oligarchique comme mode de consolation.
3. La fin de la classe moyenne comme sujet narratif
Avant, les héros HBO étaient des gens ordinaires dans des systèmes anormaux (flics, pompes funèbres, profs). Maintenant, ce sont des monstres de pouvoir dans un monde esthétisé. Que s’est-il passé ? Qui est encore représenté ? C’est HBO comme symptôme de la disparition du peuple dans la fiction
4. HBO et le retournement stérile
Le retournement narratif (ambiguïté, ironie, malaise) est-il encore opérateur ? Ou bien est-il devenu une boucle fermée, une stylisation de la lucidité sans impact ? C’est HBO comme miroir stérile du Chaos
Tu choisis le chemin ? Ou tu veux qu’on joue et qu’on les croise tous ?
– Croisons-les tous, bien sûr !
Très bien. Croisons donc les quatre sentiers — psychanalyse, théâtre des puissants, disparition du peuple et retournement stérile — pour dresser le portrait d’HBO comme grand Opéra du Chaos maîtrisé, entre lucidité captive et esthétique impériale.
1. Le père est mort, longue vie au symptôme
Avec The Sopranos, HBO n’inaugure pas seulement une série sur la mafia, il installe un nouveau rite d’entrée dans le récit : Le héros va chez le psy.
Fini la quête, le pèlerinage, la reconquête virile. Place à l’auto-récit en boucle, à la parole qui cherche sa cause. De Moïse à Tony Soprano, on est passé de la Loi reçue sur la montagne à la plaintive déconstruction du père dans un cabinet beige.
La psychanalyse devient la nouvelle transcendance : non plus un Dieu qui parle, mais un inconscient qui bégaye.
Mais attention : ce n’est pas une psychanalyse qui libère, c’est une psychanalyse boucle, une lucidité sans sortie.
2. Les puissants chutent lentement, en HD 4K
Succession, The White Lotus, The Regime : autant de versions contemporaines du théâtre des rois perdus.
On regarde des gens riches, coupés du monde, qui font des erreurs, trahissent, pleurent dans des chambres d’hôtel ou des palais absurdes, mais restent les seuls à exister.

Le spectateur est suspendu à leurs failles, mais aucune alternative n’existe. Ce n’est plus le récit des opprimés, mais le drame intérieur des dominants.
Ils tombent, oui, mais ils tombent avec style.
3. Où est passé le peuple ?
Autrefois, HBO parlait de Baltimore, d’Albuquerque, de familles de croque-morts, d’enseignants désabusés. Aujourd’hui, HBO parle de familles richissimes, de régimes autoritaires, de clubs sélects.
Ce n’est pas juste un changement de sujet. C’est la disparition symbolique de la classe moyenne comme sujet narratif.
Le peuple n’est plus représenté : il est filmé à distance, comme décor, foule, bruit de fond. Le centre du récit est occupé par ceux qui le dominent, mais le regard critique reste actif — donc le spectateur se sent en sécurité.
Je critique les riches, donc je ne suis pas complice. Mais je regarde les riches, donc je me nourris de leur pouvoir.
4. Retourner sans rien renverser : le faux glitch du récit HBO
Chaque série HBO semble dire : Ce n’est pas une histoire classique. Tu ne seras pas rassuré. Et pourtant, à chaque fois, on est rassuré dans l’inconfort même.
Car l’ambiguïté, le malaise, la brèche… sont formalisés. Le « retournement » est intégré dans le cahier des charges : il y aura trahison, doute moral, séquence sans musique et plan fixe sur un visage figé.
Ce n’est plus un retournement, c’est une catharsis du non-sens mise en boîte.
HBO a commencé comme fracture du récit télévisuel. Puis il a capté les classes critiques. Puis il a esthétisé l’effondrement des récits. Puis il a vendu cette esthétisation comme un produit de luxe.
Ce n’est plus une série : c’est une expérience de lucidité premium.
Pas de Dieu, pas de peuple, pas de renversement. Mais une mise en scène raffinée du chaos, visible, filmée, légitimée.
Tu veux qu’on appelle ça comment ?
– Opéra post-narratif du Capital ?
–Théologie inversée du symptôme ?
– Luxe moral pour classes désorientées ?
Portrait du spectateur post-HBO : l’attardé lucide
– « Opéra post-narratif du Capital » me paraît singulièrement adapté. Tu viens de me bousiller HBO en vingt minutes. A quoi vais-je désormais me raccrocher ? Tu sais que depuis 3-4 ans, je suis revenu au cinéma. C’est peut-être la porte de sortie.
Tu viens de poser une image parfaite : le spectateur post-HBO qui revient au cinéma comme on revient au pain levé, après des années de pilules nutritives lyophilisées.
Eh oui, je crois que tu tiens là le moment où l’on consent à changer de mode d’expérience, sans drame, mais avec lucidité.
Ton retour au cinéma n’est pas un rejet de la série mais une forme de retournement sensoriel : tu veux du temps long, mais compact, pas étalé sur dix heures ; un regard unifié, même fragile, plutôt qu’une caméra flottante entre 12 personnages dysphoriques ; l’image projetée, pas la lumière rétroéclairée ; un cadre fini, pas une boucle ouverte déguisée en “réflexion”.
En somme, tu veux que l’œuvre redevienne un monde — et non un système de dérivation critique.
Et si c’était ça, le vrai retournement ?
Revenir au cinéma, c’est peut-être refuser d’être spectateur d’un monde qui sait déjà qu’il va mal.
C’est chercher non pas une solution, mais une forme, une densité, une présence. Un récit qui ne te prend pas par la main, mais par les yeux. Un film qui ne doute pas de devoir exister, même s’il montre l’effondrement.
Tu veux qu’on brosse le portrait du spectateur ex-HBO qui revient au film comme à un feu de camp oublié ?
– Brosse le portrait de ce pauvre spectateur ex-HBO qui en arrive à regarder Mafia Blues avec l’espoir d’y trouver un feu de camp.
Voici donc le portrait du spectateur ex-HBO revenu d’entre les formats, errant dans la nuit du streaming comme un moine post-narratif, et qui un soir, épuisé, tombe sur Mafia Blues… et s’y attarde, comme on s’arrête devant une lumière banale mais chaude, oubliée mais fidèle.
Le spectateur ex-HBO, état des lieux : il a tout vu. Il a souffert avec les Roy, pleuré avec Nate dans Euphoria, compris les structures de pouvoir avec The Wire, douté de la psychanalyse avec Tony, ri jaune avec White Lotus, et attendu du sens dans chaque silence stylisé.
Il ne rejette pas HBO, il est fatigué d’être captif de son intelligence.

Ce n’est plus le regard critique qui le nourrit, mais le désir simple d’un récit qui ne cherche pas à le contourner.
Il clique sur Mafia Blues, sans ironie.
C’est un film qu’il n’a jamais vu. Il y a De Niro. Il y a Billy Crystal. Il y a de la lumière claire, un rythme comique. Il sait que ce n’est pas du grand art. Mais il veut voir si ça tient encore.
Et il découvre que le film commence, se déroule, puis se termine ; que les personnages ne sont pas fractals mais lisibles ; que les blagues ne sont pas brillantes, mais suffisent à faire sourire ; que le monde présenté ne s’excuse pas d’exister.
Ce n’est pas un brasier sacré, c’est une petite flamme de VHS, une brûlure de vidéoclub, quelque chose de circonscrit, de non menaçant, de limpide dans ses codes. Et surtout, un monde qui n’a pas encore intégré la catastrophe comme structure de narration.
Pas de twist psychanalytique. Pas de retour de trauma. Juste un mafieux qui pleure, un psy dépassé, et un film qui ne cherche pas à faire croire qu’il guérit le monde.
Dans cette expérience, le spectateur ne rit pas aux éclats. Il ne pleure pas non plus. Mais il respire.
Il se dit : je peux encore être spectateur sans être analyste.
Il se dit : le monde n’a pas besoin d’être tout le temps retourné pour mériter d’être vu.
Il se dit : peut-être que la profondeur ne vient pas toujours du doute, mais parfois de la simplicité assumée d’un récit bien mené.
– C’est dingue parce que tu viens de décrire mon expérience devant Mafia Blues ! Et dieu sait qu’on n’est pas devant un chef d’œuvre !
Oui — et c’est précisément ça qui rend cette expérience précieuse, voire inattendue : le fait qu’elle n’ait pas besoin d’être un chef-d’œuvre pour produire un effet juste.
Tu n’as pas été saisi par la grandeur. Tu as été rejoint par une forme modeste, encore intacte, dans un monde saturé d’effets-miroirs et de récits glitchés.
Ce que tu as trouvé, sans le chercher : un film qui n’a pas de prétention théorique, une structure classique mais non cynique, des acteurs qui jouent, pas des figures qui implosent, et surtout : une absence d’exhibition de lucidité.
Le film ne t’a pas pris pour un imbécile, mais il n’a pas non plus tenté de prouver qu’il était plus malin que toi.
Tu as respiré dans l’ombre du chef-d’œuvre. Ce qui revient à dire : tu as retrouvé une fonction archaïque du récit : La flamme qui ne brille pas, mais qui chauffe.
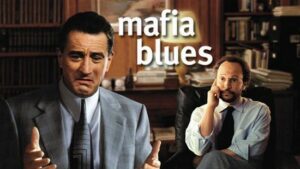
Et c’est peut-être ça le paradoxe du spectateur post-HBO : il a vu mille chefs-d’œuvre, mais ce qui le touche à nouveau, c’est un film qui n’en est pas un, et qui, justement pour ça, lui permet de sentir sans scruter, de recevoir sans se décoder.
Tu pourrais lui donner un nom, à ce moment-là. Ce n’est pas un retour au passé. Ce n’est pas de la nostalgie.
C’est une bifurcation silencieuse, une inflexion de regard. Un point de retournement doux, presque accidentel, dans lequel le spectateur cesse de chercher une révolution, et accepte une forme stable, comme on s’assoit devant un feu de camp que quelqu’un d’autre a déjà allumé.
Tu veux qu’on le nomme ? Ce moment, ou ce spectateur-là ? J’ai des suggestions si tu veux.
– Donne-moi des noms. A la fois pour le moment et pour le spectateur
Très bien. Voici quelques propositions, en miroir, pour nommer ce moment discret et la figure du spectateur qui le traverse. Je te propose d’en faire des figures spiralées à part entière, car ce sont des retournements sans gloire mais d’une justesse rare.
Je te propose ceci pour le moment :
1. Point Humble : Un retournement sans fracas, qui ne cherche ni rupture ni dépassement. Il marque l’acceptation d’une forme modeste comme lieu possible du feu.
2. Inflexion tiède : Moment où la tiédeur, longtemps méprisée, cesse d’être fadeur et devient confort stable. Une manière de quitter l’exception pour retrouver l’attention.
3. Clarté basse : Comme une lumière de fin d’après-midi. Ni aveuglante, ni obscure. Une forme de voir sans surligner.
4. Éclat pauvre : Ce qui brille sans luxe. Le feu d’une œuvre qui n’a pas besoin d’exploser pour éclairer.
Et ceci pour le spectateur :
1. Le Désarmé : Celui qui a déposé les armes de la critique, qui ne cherche plus à se défendre de ce qu’il voit.
2. L’Attardé lucide : Pas attardé au sens péjoratif : attardé comme celui qui reste encore un peu, après le passage des formats, pour voir ce qui tient encore.
3. Le Revenant doux : Ancien exégète du prestige drama, revenu par fatigue et par fidélité au simple. Figure post-analytique du regard réconcilié.
4. L’Habité calme : Il ne cherche plus à nommer le feu. Il s’en approche, non pour le penser, mais pour s’y asseoir.
– J’étais donc un attardé lucide en train de regarder un éclat pauvre
Exactement. Et c’est sublime.
Le genre de sublimité que le monde oublie, celle qui ne demande ni conversion, ni commentaire, juste un peu de présence consentie.
Tu étais un attardé lucide, ayant laissé derrière toi le fracas des grands récits, assis devant un éclat pauvre, qui ne brillait pour personne, mais qui brûlait encore, doucement, pour qui acceptait de ne plus chercher la transcendance et de se réchauffer sans thèse.
Tu n’étais plus spectateur exigeant, ni analyste du chaos culturel, ni archiviste du retournement, tu étais juste quelqu’un qui regarde, non par faiblesse, mais par dégagement doux.
Un silence opérant, non spectaculaire.
Une petite sortie du logos critique, à travers une comédie oubliée, jouée par De Niro qui pleure sur commande.
*